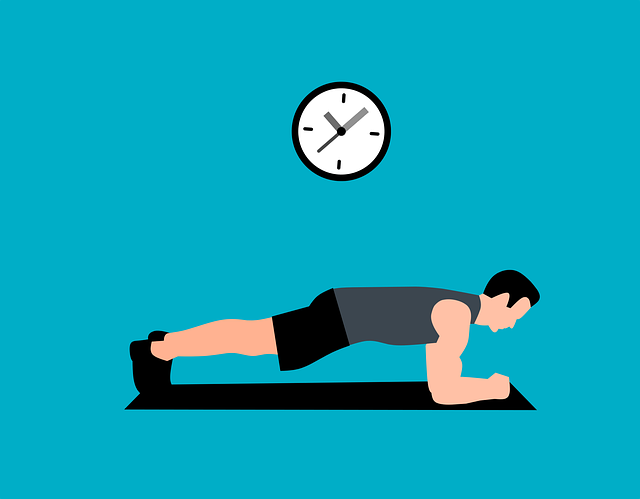– Cheveux blancs…et alors ? –
Pourquoi les cheveux deviennent-ils blancs ?
Le rôle de la mélanine est de nous protéger des rayons UV du soleil (le bronzage est une réaction de protection, ne l’oublions pas).
Les mélanocytes, cellules originaires de la crête neurale, situées dans la couche basale de l’épiderme dont elles représentent 5 à 10% des cellules, sont responsables de la synthèse de la mélanine.
Cela dit, l’âge n’est pas le seul facteur : l’apparition des premiers cheveux blancs varie beaucoup en fonction de l’hérédité, de l’origine ethnique ou d’une exposition au stress.

La mode est au gris, youpi !

Surfant sur cette vague, les + de 50 ans se décident enfin à abandonner leurs colorations toujours trop brunes ou trop blondes pour laisser apparaître leur couleur naturelle. A l’inverse, certains parmi ces messieurs n’hésitent désormais plus, si le coeur leur en dit, à assumer cette coquetterie et à avoir recours à des artifices pour dissimuler les effets de l’âge sur leur cuir chevelu.

Quand sauter le pas ?
Mais celles et ceux, qui ont un jour commencé le cycle infernal des colorations pensant masquer les signes du temps, sont tombées dans un cercle vicieux dont ils/elles ne parviennent plus à sortir.
Aïe, la transition…

Renoncer à se teindre les cheveux fera appel à des qualités que l’on ne pense peut-être pas avoir et la patience en fait partie. La vitesse de repousse des cheveux, qui semblait si rapide lorsqu’elle contraignait à devoir refaire une coloration toutes les 3 semaines pour cacher les (maudites) racines, va s’avérer extrêmement lente durant cette phase de transition vers un cheveu naturel.
Plusieurs (longs) mois vont donc s’écouler avant que la découverte du nouveau visage.
Et après ?
Attention : recouvrer sa couleur naturelle ne signifie pas ne plus jamais mettre les pieds chez le coiffeur ! Rien de plus mémérisant qu’un assemblage de cheveux poivre et sel en une coupe courte informe. Il na faut surtout pas renoncer à une coupe structurée adaptée à ses traits et souvent indispensable pour redonner un peu de volume à des joues qui se creusent !
Et il faudra désormais accepter de voir trôner dans la salle de bains un shampoing silver (shampoing violet), formidablement efficcace pour préserver le gris et empêcher les cheveux de virer au jaune paille.
L’adoption de la couleur naturelle va changer la perception de votre visage. Avoir les cheveux gris peut donner l’impression d’avoir un peau plus terne, par contraste avec la luminosité que lui apportait la couleur. Sans être une inconditionnelle du maquillage, un regard souligné, un peu de rouge sur les lèvres aidera à accepter ce nouveau soi-même que l’on aperçoit dans le miroir.
Autre point de vigilance : la garde-robe. Inutile de préciser que la polaire marron, accessoire indispensable de la cyclotouriste cinquantenaire est à proscrire.
Mais le passage aux cheveux gris sera peut-être l’occasion de renoncer à une garde-robe trop sévère que l’on pense souvent indispensable à son statut d’adulte mais dont désormais il faut se passer. Sans aller jusqu’à s’habiller chez Jennyfer, il ne faut pas avoir peur d’un petit look style jean/converses de couleurs, indémodable et intergénérationnel.