A découvrir...
La question du bien-être animal émerge chaque fois que les humains interfèrent avec les animaux. Elle concerne l’élevage, mais également l’utilisation des animaux à des fins de recherche scientifique et d’enseignement, les activités de chasse, de pêche ou celles sportives et culturelles (zoos, corridas…). Le rapport aux animaux de compagnie, dont certains nous assistent (chiens d’avalanche, chiens guides d’aveugle, brigades canines, chevaux etc.) est également concerné.
Pour toutes ces pratiques qui mettent en jeu des animaux et leur bien-être, le contrôle de la puissance publique et la mise en place de cadres réglementaires sont de plus en plus considérés comme une exigence sociétale.
Le bien-être animal : une attente sociétale forte
Associations de protection animale

Depuis plusieurs années, certaines associations de protection animale portent la contestation à l’encontre de la production agricole française, avec des velléités
- abolitionnistes : leur but est de mettre fin à toute forme d’exploitation des animaux et leur combat est porté par des campagnes choc.
- welfaristes : elles ne remettent pas en question l’élevage mais œuvrent pour l’amélioration de la condition des animaux.
Médias
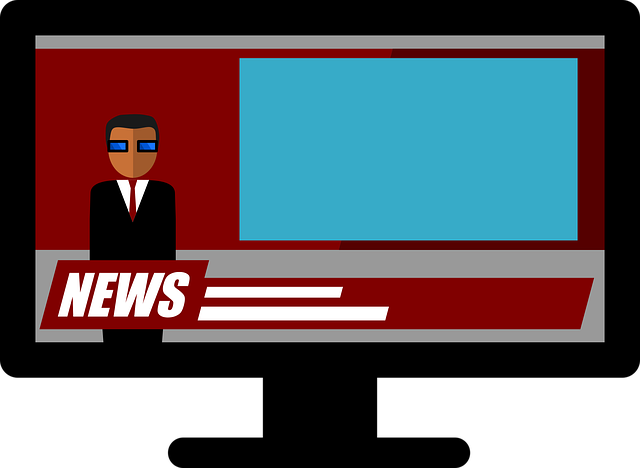
Les conditions de vie et d’abattage des animaux d’élevage font régulièrement la une des journaux d’information télévisés et circulent en boucle sur les réseaux sociaux, notamment grâce aux témoignages choc qu’apportent les vidéos de L214.
En outre, tauromachie, chasse à courre, chasse à la glu et autres « traditions » génératrices de souffrances pour les animaux sont régulièrement au cœur de l’actualité.
Citoyens / consommateurs

Selon une étude de l’IFOP parue en janvier 2021, les français sont cette année encore plus des deux tiers (69%) à estimer que les politiques ne défendent pas suffisamment bien les animaux.
Ils se déclarent toujours très majoritairement favorables à l’interdiction de toute expérimentation animale (89%, +3 points en un an), de l’élevage intensif (85%, +4), de la chasse à courre (77%), des corridas en France (75%) et de la présence d’animaux sauvages dans les cirques (72%).
Neuf Français sur dix sont toujours opposés au commerce de la fourrure (90%).
En parallèle, on observe une évolution des consommations alimentaires (flexitarisme, végétarisme, véganisme) et, surtout, un attrait du consommateurs pour les filières plein air ou bio.
Industriels

Le classement « Business Benchmark on Farm Animal Welfare » (BBFAW) publie chaque année les progrès en termes de bien-être animal des grands groupes du secteur agroalimentaire, évalués sur la base de leurs engagements et des informations rendues publiques.
Le classement 2020 souligne qu’environ deux tiers des entreprises gèrent activement les risques et les opportunités liés au bien-être animal. En particulier, 79 % des grands groupes alimentaires se sont engagés à atteindre des objectifs précis sur le bien-être animal.
Pouvoirs publics

Ce débat nourri sur le bien-être animal se formalisme, tant au niveau national qu’européen, par des colloques ou des publications mais également des propositions de lois.
Ces dernières années, les pouvoirs publics ont ainsi agi concrètement :
- modification du code civil en 2015.
- vote de lois, par exemple, la loi de lutte contre la maltraitance adoptée par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2021
- publication d’arrêtés ou de décrets, par exemple, décret du 18 décembre 2020 qui prévoit la création d’un référent bien-être animal dans chaque élevage et vise à limiter les souffrances inutiles envers les animaux.
Les initiatives…et les freins
Le RIP
Un projet de référendum d’initiative partagée, est présenté le 2 juillet 2020, afin de réfléchir à une proposition de loi visant à « améliorer le sort de 1 milliard d’animaux en France ». Il est porté par trois grands patrons de la tech, Xavier Niel (groupe Iliad), Marc Simoncini (fondateur du site Meetic) et Jacques-Antoine Granjon (Veepee), par le journaliste Hugo Clément associés à une vingtaine d’associations de défense des animaux et de protection de l’environnement.

L’objectif du RIP est de faire valoir six propositions : l’interdiction de l’expérimentation animale (en cas d’alternatives), de l’élevage en cage et pour la fourrure, des spectacles d’animaux sauvages, de la chasse à courre et traditionnelle, et la sortie de l’élevage intensif d’ici à 2040.
Comme le prévoit la réforme constitutionnelle de 2008, toutes les mesures ne pourront être soumises à un RIP qu’après avoir franchi plusieurs étapes. D’abord, un cinquième des membres du Parlement (185 parlementaires) doivent donner leur accord. A ce moment-là seulement, les organisateurs auront neuf mois pour recueillir les signatures des citoyens, sachant que le RIP ne pourrait éventuellement être déclenché que si 10 % du corps électoral (4,7 millions de citoyens) soutiennent l’initiative.
Une tâche ardue…
Au l’initiative avait recueilli l’appui de 151 parlementaires sur les 185 nécessaires pour l’organisation du référendum, loin du seuil mais suffisant pour démontrer que la cause animale s’est définitivement installée dans l’agenda politique.
En effet, ce sont des parlementaires de tout bord qui se sont ralliés à cette idée. « La diversité politique des parlementaires est assez révélatrice de la force de cette initiative. C’est très important pour nous car la question de la condition animale est transpartisane », affirme Hugo Clément .
Les politiques l’ont bien senti, l’attente des électeurs est réelle. Avec un demi-million de voix et un score de 2,2 % aux élections européennes de 2019, le Parti animaliste avait déjà imposé la thématique dans le débat public. Désormais, les députés n’hésitent plus à signer en nombre des propositions de loi sur le sujet ; ils sont donc plus de 150 à défendre l’amélioration du bien‑être des animaux de compagnie et une soixantaine pour l’amélioration de la condition animale et la lutte contre la maltraitance.
Les actes
Le 30 novembre 2021 est promulguée la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (voir article le bien-être animal (1) : historique et définition).
Elle instaure notamment :
- un nouveau certificat pour l’acquisition d’un animal de compagnie,
- des sanctions renforcées en cas de sévices et de zoophilie,
- la fin des delphinariums en 2026 et des animaux sauvages dans les cirques itinérants en 2028.

D’autres petites avancées sont faites de ci de là :
- expérimentation d’un repas végétarien ou végétalien par semaine dans certaines cantines scolaires depuis novembre 2019.
- annonce de la fin du broyage des poussins et de la castration à vif des porcelets fin 2021.
Mais, malgré la loi EGalim (« loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous », votée en 2018 et issue des États généraux de l’alimentation lancés en 2017.), le modèle agro-industriel, quant à lui, n’est pas remis en question.
L’Hexagone est à ce titre en retard sur d’autres pays européens. La question du bien-être animal est, par exemple, intégrée dans les Constitutions allemande et autrichienne, et le Parti des animaux néerlandais est représenté au Parlement européen. La France, elle, freine, et n’applique pas systématiquement les directives européennes de protection animale, par exemple pour la chasse à la glu ou lors de la mise à mort des animaux dans les abattoirs.
Les lobbies
Car les avancées observées ne se font pas sans mal : les parlementaires restent frileux, sensibles à l’influence des lobbies, tout particulièrement celui de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs de la FNSEA et des chasseurs. Même si ces derniers perdent du terrain, leur emprise reste forte, y compris auprès d’un chef de l’Etat qui les cajole.
Ainsi le Conseil d’Etat avait rejeté en 2019 une demande d’interdiction de cette méthode «traditionnelle» qui consiste à capturer des oiseaux à l’aide de tiges en bois enduites de glu et posées sur des arbres ou buissons, estimant que la réglementation prévoit «un régime d’autorisation et de contrôle rigoureux». L’Association nationale de défense des chasses traditionnelles à la grive, saluant à l’époque la décision du Conseil d’Etat, avait de son côté dénoncé sur son site Internet des «campagnes de dénigrement infondées» de la part d’«ayatollahs, apôtres de la pensée unique».
Il a fallu que la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) en appelle à la juridiction européenne afin que celle-ci somme la France de se mettre en conformité.

Les chasseurs se sont également fortement mobilisés contre le RIP, première étape, selon eux, d’une interdiction totale de la chasse.
De leur côté, les fédérations de professionnels de la filière viande ou de la chasse (Fédération nationale des chasseurs, la FNSEA, la Société centrale canine) mènent des actions de lobbying intenses auprès des élus «pour que rien ne change au sujet de la cause animale». La France est la « lanterne rouge » de l’Europe sur la question du bien-être animal, qui se joue souvent à l’échelon européen et a tenté, par exemple, de bloquer l’interdiction de l’expérimentation animale pour les cosmétiques.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux et ministre de la Justice, est un fervent défenseur de la chasse, et a notamment préfacé avant son entrée au gouvernement un livre de Willy Schraen (Un chasseur en campagne) où ce dernier qualifie certains militants écologistes « d’intégristes » et « d’illuminés » et les défenseurs de la cause animale d’« ayatollahs de l’écologie (qui se serviront du livre) pour allumer le barbecue où ils cuiront leurs steaks de soja ». Il y dresse également un portrait élogieux d’Emmanuel Macron, avec lequel il se targue d’avoir des liens privilégiés.

De son côté, l’industrie de la fourrure dénonce la substitution de ce produit naturel par des peaux synthétiques faites de matières plastiques nocives pour l’environnement. En novembre, la Fourrure française a écrit une lettre ouverte au magazine Vogue France jugeant «absurde» de «désigner des vêtements en matière plastique comme éco-friendly parce que réalisés à partir de matières soigneusement sélectionnées de fourrure acrylique et modacrylique». La filière française de la fourrure estime que les décisions des créateurs et des consommateurs sont dues à un «climat de terreur» provoqué par «la violence et le harcèlement» des militants défendant la cause animale.
Et autres freins
Enfin, la deuxième chambre, le Sénat, reste très éloignée des préoccupations des Français et des Françaises. Ne devant rendre des comptes qu’à des élus locaux, et non aux citoyens, ils sont parfois déconnectés de la réalité. Ils ont, par exemple, été très surpris de voir les réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias après leur lecture en commission du texte relatif à la loi sur le bien-être animal et ont tendance à sous-estimer l’impact de ces questions dans l’opinion publique.
Un élément clef de différenciation marketing
La diffusion des vidéos dénonçant de mauvais traitements envers les animaux élevés pour une marque précise bouleversent de plus en plus les Français. Beaucoup déclarent être prêts à boycotter une marque qui serait responsable de tels agissements.
Le bien-être animal devient donc, aussi, un élément clef de différenciation marketing.
Ainsi, quatre ONG de protection animale (LFDA, CIWF, OABA, WELFARM), trois distributeurs (le groupe Casino, le groupe Carrefour, les magasins U) et des producteurs de volailles (Les Fermiers de Loué, Les Fermiers du Sud-Ouest, Galliance), ont travaillé avec l’INRAE à une évolution de l’étiquetage des poulets, coconstruit dans une volonté commune d’accompagner le progrès de la filière tout en informant le consommateur de manière claire, fiable et robuste.
Cet étiquetage prévu pour tous les produits, quel que soit leur niveau de gamme, permet de donner une information claire et fiable au consommateur sur le niveau de bien-être animal associé aux produits commercialisés pour leur permettre d’orienter leurs achats. Il encourage également les éleveurs qui pourront développer et mieux valoriser leurs pratiques en faveur du bien-être animal.
L’étiquetage repose toujours sur un référentiel technique de 230 critères, qui couvrent les différentes étapes de la vie de l’animal, depuis la naissance, jusqu’à l’abattage en passant par le transport, et comprenant dorénavant 5 niveaux :
- Les trois premiers niveaux A, B et C valorisent des pratiques garantissant une amélioration significative du bien-être animal, ils ont un niveau d’exigence croissant, avec par exemple l’obligation d’un accès extérieur aux niveaux A et B ;
- Les niveaux D et E informent le consommateur, en toute transparence, que les pratiques correspondent à un niveau minimal réglementaire (E), ou à quelques exigences complémentaires avec une mise en place de plans de progrès (D).
L’étiquette présente désormais aussi un pictogramme indiquant le mode d’élevage associé (ex. accès à l’extérieur ou élevage en bâtiment) pour répondre à la préoccupation des consommateurs.

La condition des animaux, dont l’intelligence a été démontrée par l’éthologie et la sensibilité reconnue par la loi, doit être améliorée et mieux respectée.
Et c’est bien l’évolution de l’opinion en ce sens qui porte le débat et incite à l’action les pouvoirs publics.
A poursuivre, pour eux, pour nous…

Sources : Wikipedia.org – anses.fr – agriculture.gouv.fr – fawec.org – ciwf.fr – oie.int – L214.com – popsciences.universite-lyon.fr – Le Monde – terrena.fr

